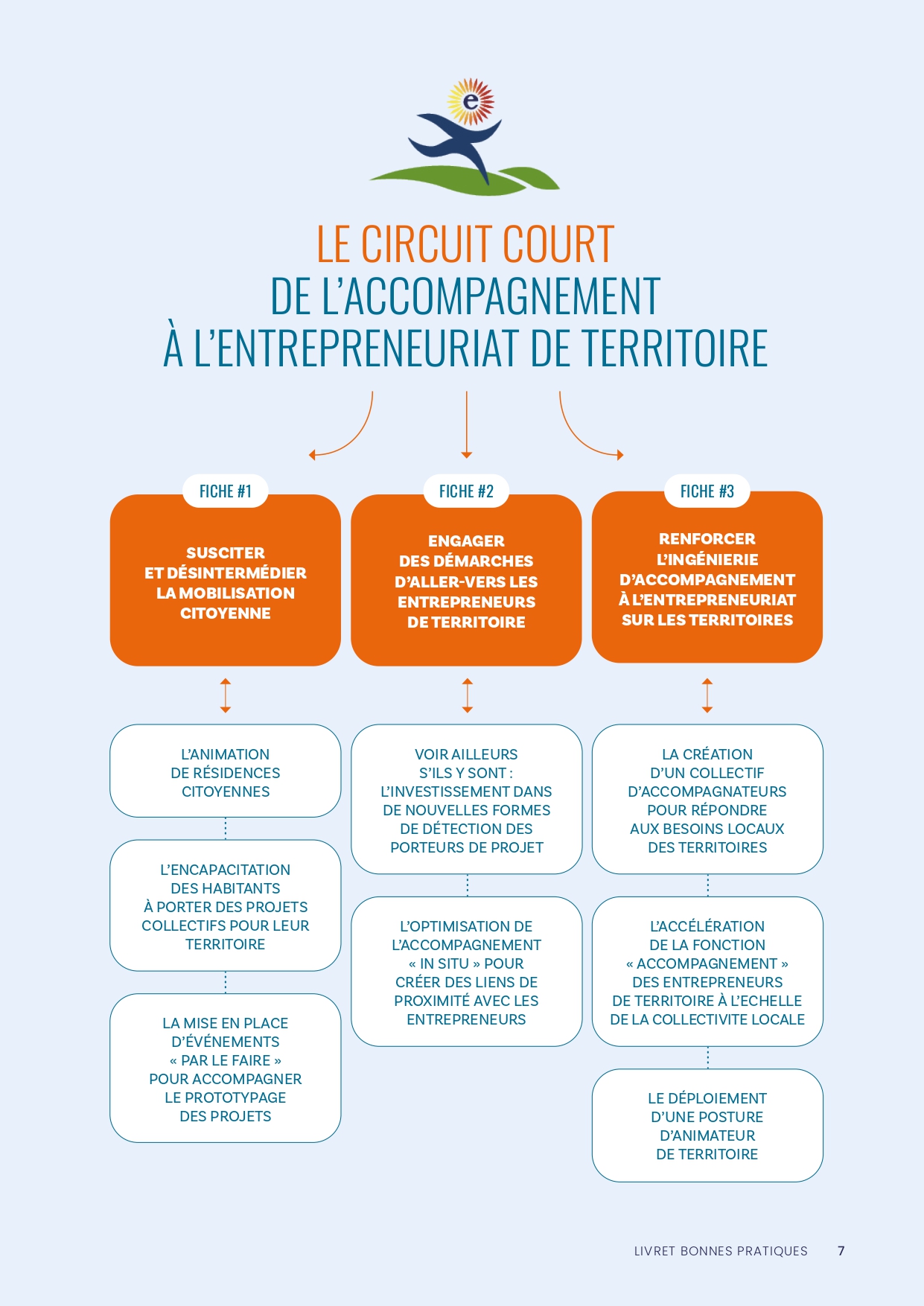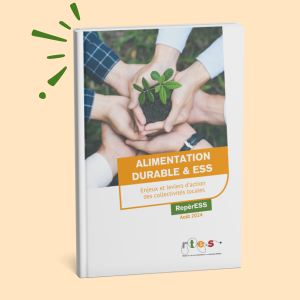Une collectivité peut-elle recourir à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ?
La question s’est posée pour différentes collectivités territoriales (CT) membres du RTES, quant aux possibilités de recourir à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). L’essor des collectivités souhaitant notamment exploiter elles-mêmes leurs parcelles agricoles en régie publique pour fournir leur cantine soulève l’opportunité pour elles de mobiliser une CUMA de leur territoire.
La FAQ juridique est réservée aux collectivités adhérentes du RTES. Dans le cadre de TRESSONS 2024/2025, le RTES ouvre sa FAQ juridique à toutes les collectivités rurales, sur les questions autour de l'appui à l'installation agricole, des formes d'emploi, et plus largement du soutien à la création d'activités en lien avec l'ESS. Cette question juridique est donc disponible pour toutes les collectivités, adhérentes et non adhérentes au RTES. Retrouvez toutes les questions juridiques traitées dans notre Foire aux Questions juridique !
La collectivité adhérente
L’adhésion d’une collectivité à une CUMA de son territoire est admise sur le fondement des 1° ou 2° de l’article L522-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), comme personne morale agricultrice (simplement en exerçant une activité agricole au sens large, pour les personnes de droit public selon le 4° de l’article D614-1) ou possédant des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la CUMA et souscrivant un engagement coopératif d'activité ainsi que les parts sociales correspondantes. Une réponse ministérielle (publiée au JO AN en réponse à QE n°208) a précisé que cet engagement d’activité fondant cette adhésion, ne pouvait porter que sur le domaine privé agricole ou forestier d’une collectivité ou EPCI.
Pour la collectivité comme pour les autres agriculteurs, un intérêt de recourir à une CUMA en tant que coopérateur est de pouvoir bénéficier ainsi d’un prix de service non seulement plus bas car mutualisé mais aussi exonéré de TVA, soit une économie de 20%, par rapport à un client tiers.
La collectivité tierce bénéficiaire
La collectivité peut également avoir recours au service d’une CUMA de son territoire ou d’un autre territoire comme bénéficiaire non associée - le cas échéant en s'acquittant de la TVA. Une CUMA, comme toute coopérative, doit en principe agir pour ses associés coopérateurs. Mais le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoient deux types de dérogation possibles, l’une générale et l’autre pour les petites collectivités rurales (résumées au §110 du BOFIP n°BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30) :
dérogation de droit commun à l’exclusivisme coopératif
Lorsque les statuts le prévoient, la CUMA peut effectuer des opérations correspondant à son objet (c’est-à-dire les mêmes opérations que celles réalisées avec les adhérents) avec des tiers non associés dans la limite de 20% de son chiffre d'affaires annuel. Cette dérogation à l’exclusivisme permet de travailler pour toutes les collectivités locales et pour l’ensemble du territoire (domaine public et privé), y compris en soumissionnant à des marchés publics. Elle permet également de ne plus avoir de contrainte de territorialité ; la collectivité locale pouvant se situer hors circonscription territoriale de la CUMA.
La CUMA est dispensée d’y avoir été préalablement autorisé par ses statuts (l’option légale) depuis la loi du 09 janvier 1985 sur la protection de la Montagne, au bénéfice des seules collectivités territoriales (mais aussi des associations foncières et des associations syndicales autorisées de propriétaires), en cas d’appel d’offres infructueux ou dans le cadre de marché public de faible importance.
dérogation particulière au bénéfice des petites collectivités rurales et leurs EPCI
Codifié à l’article L522-6 du CRPM, l’article 20 de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a autorisé la CUMA à réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural, conformes à son objet social, pour le compte de petites communes, dans les limites de 25 % de son chiffre d’affaires annuel et de 10 000 euros et 15 000 euros en zone de revitalisation rurale. Depuis la Loi ESS de 2014, peuvent en bénéficier les communes de moins de 3500 habitants et les groupements composés au ¾ de communes de moins de 3500 habitants à conditions que le siège d’au moins une des exploitations membres de la CUMA se situe dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités. Le seuil de 25 % du chiffre d’affaires annuel (dans la limite de 10 000 euros) est exclusif du seuil de 20 % du chiffre d’affaires relatif aux opérations réalisées avec les tiers non coopérateurs. Ainsi une CUMA peut réaliser jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires annuel avec des tiers non coopérateurs dans les conditions ci-avant.
La collectivité partenaire
Les collectivités peuvent également soutenir plus largement le développement de CUMA sur leur territoire (par exemple en prenant en charge une partie de l’adhésion à une CUMA pour des jeunes agriculteurs, comme c’est le cas pour le Département de la Nièvre). Elles veillent en général à ne pas subventionner même indirectement la production, mais à soutenir des projets en faveur plus largement du territoire. Il peut s'agir d'appui au développement de groupement d'employeurs, d'inscription des CUMA dans les PAT, etc...
Retrouvez toutes les questions juridiques traitées par le RTES dans sa Foire aux Questions : www.rtes.fr/foire-aux-questions-faq-juridique

La question s’est posée pour différentes collectivités territoriales (CT) membres du RTES, quant aux possibilités de recourir à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). L’essor des collectivités souhaitant notamment exploiter elles-mêmes leurs parcelles agricoles en régie publique pour fournir leur cantine soulève l’opportunité pour elles de mobiliser une CUMA de leur territoire.
La FAQ juridique est réservée aux collectivités adhérentes du RTES. Dans le cadre de TRESSONS 2024/2025, le RTES ouvre sa FAQ juridique à toutes les collectivités rurales, sur les questions autour de l'appui à l'installation agricole, des formes d'emploi, et plus largement du soutien à la création d'activités en lien avec l'ESS. Cette question juridique est donc disponible pour toutes les collectivités, adhérentes et non adhérentes au RTES. Retrouvez toutes les questions juridiques traitées dans notre Foire aux Questions juridique !
La collectivité adhérente
L’adhésion d’une collectivité à une CUMA de son territoire est admise sur le fondement des 1° ou 2° de l’article L522-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), comme personne morale agricultrice (simplement en exerçant une activité agricole au sens large, pour les personnes de droit public selon le 4° de l’article D614-1) ou possédant des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la CUMA et souscrivant un engagement coopératif d'activité ainsi que les parts sociales correspondantes. Une réponse ministérielle (publiée au JO AN en réponse à QE n°208) a précisé que cet engagement d’activité fondant cette adhésion, ne pouvait porter que sur le domaine privé agricole ou forestier d’une collectivité ou EPCI.
Pour la collectivité comme pour les autres agriculteurs, un intérêt de recourir à une CUMA en tant que coopérateur est de pouvoir bénéficier ainsi d’un prix de service non seulement plus bas car mutualisé mais aussi exonéré de TVA, soit une économie de 20%, par rapport à un client tiers.
La collectivité tierce bénéficiaire
La collectivité peut également avoir recours au service d’une CUMA de son territoire ou d’un autre territoire comme bénéficiaire non associée - le cas échéant en s'acquittant de la TVA. Une CUMA, comme toute coopérative, doit en principe agir pour ses associés coopérateurs. Mais le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoient deux types de dérogation possibles, l’une générale et l’autre pour les petites collectivités rurales (résumées au §110 du BOFIP n°BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30) :
dérogation de droit commun à l’exclusivisme coopératif
Lorsque les statuts le prévoient, la CUMA peut effectuer des opérations correspondant à son objet (c’est-à-dire les mêmes opérations que celles réalisées avec les adhérents) avec des tiers non associés dans la limite de 20% de son chiffre d'affaires annuel. Cette dérogation à l’exclusivisme permet de travailler pour toutes les collectivités locales et pour l’ensemble du territoire (domaine public et privé), y compris en soumissionnant à des marchés publics. Elle permet également de ne plus avoir de contrainte de territorialité ; la collectivité locale pouvant se situer hors circonscription territoriale de la CUMA.
La CUMA est dispensée d’y avoir été préalablement autorisé par ses statuts (l’option légale) depuis la loi du 09 janvier 1985 sur la protection de la Montagne, au bénéfice des seules collectivités territoriales (mais aussi des associations foncières et des associations syndicales autorisées de propriétaires), en cas d’appel d’offres infructueux ou dans le cadre de marché public de faible importance.
dérogation particulière au bénéfice des petites collectivités rurales et leurs EPCI
Codifié à l’article L522-6 du CRPM, l’article 20 de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a autorisé la CUMA à réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural, conformes à son objet social, pour le compte de petites communes, dans les limites de 25 % de son chiffre d’affaires annuel et de 10 000 euros et 15 000 euros en zone de revitalisation rurale. Depuis la Loi ESS de 2014, peuvent en bénéficier les communes de moins de 3500 habitants et les groupements composés au ¾ de communes de moins de 3500 habitants à conditions que le siège d’au moins une des exploitations membres de la CUMA se situe dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités. Le seuil de 25 % du chiffre d’affaires annuel (dans la limite de 10 000 euros) est exclusif du seuil de 20 % du chiffre d’affaires relatif aux opérations réalisées avec les tiers non coopérateurs. Ainsi une CUMA peut réaliser jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires annuel avec des tiers non coopérateurs dans les conditions ci-avant.
La collectivité partenaire
Les collectivités peuvent également soutenir plus largement le développement de CUMA sur leur territoire (par exemple en prenant en charge une partie de l’adhésion à une CUMA pour des jeunes agriculteurs, comme c’est le cas pour le Département de la Nièvre). Elles veillent en général à ne pas subventionner même indirectement la production, mais à soutenir des projets en faveur plus largement du territoire. Il peut s'agir d'appui au développement de groupement d'employeurs, d'inscription des CUMA dans les PAT, etc...
Retrouvez toutes les questions juridiques traitées par le RTES dans sa Foire aux Questions : www.rtes.fr/foire-aux-questions-faq-juridique