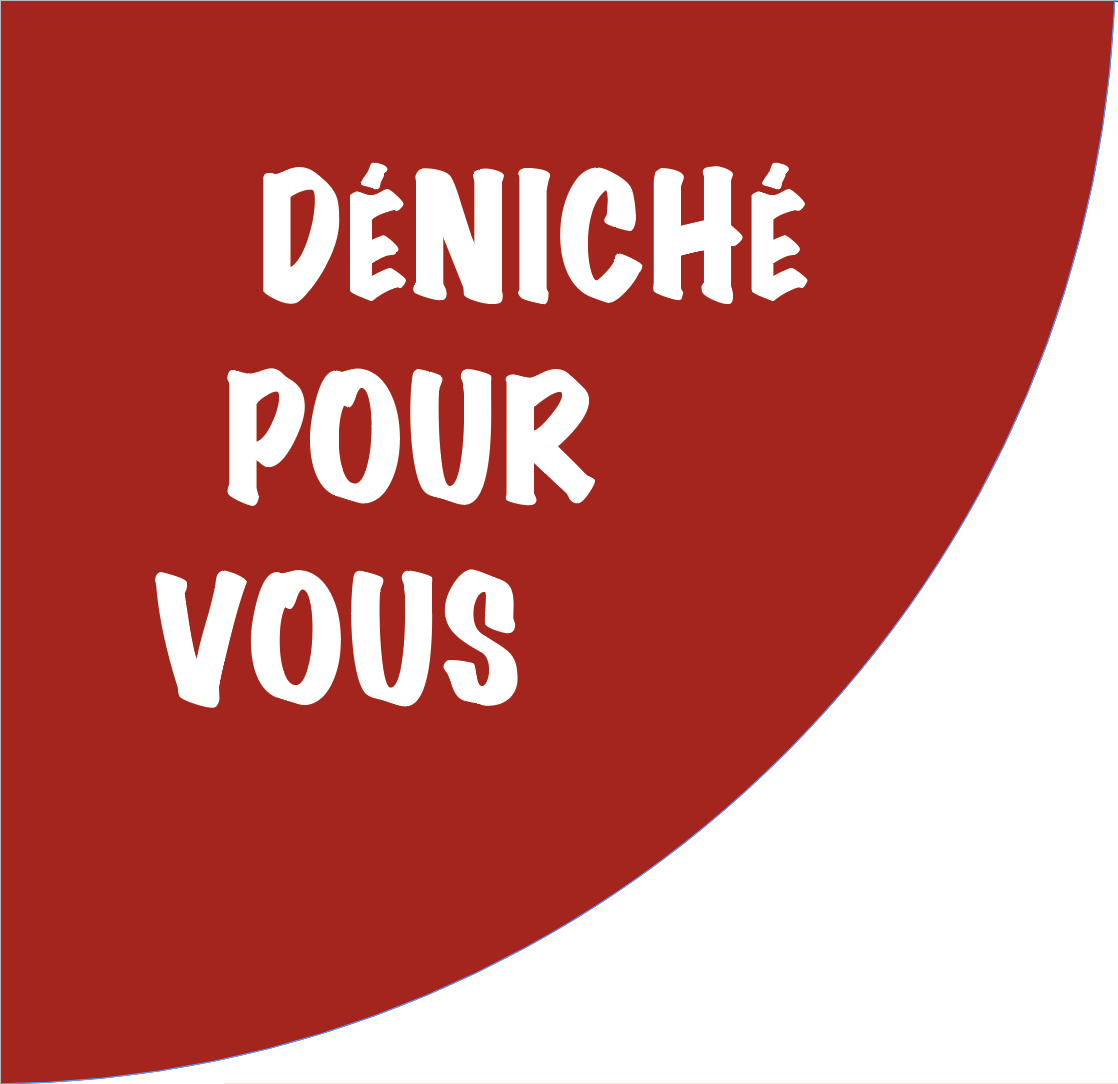« Le portage foncier agricole, levier pour une agriculture en transition ? » • Rapport Terre de Liens 2024
Terre de Liens dénonce dans un nouveau rapport le trop difficile accès aux terres agricoles. Alors que la France entend se doter en 2024 d’une loi en faveur du renouvellement des générations agricoles - duquel dépend notre souveraineté alimentaire, les nouveaux chiffres de Terre de Liens montrent qu’il sera impossible d’endiguer la disparition des fermes et des agriculteur·trices si le gouvernement ne réhausse pas drastiquement son investissement.
Telles que programmées, les aides de l'Etat couvrent 0,5% des besoins en installation.
Bientôt une France sans paysan·nes ?
La colère et le désespoir exprimés avec force lors des mobilisations de janvier pourraient laisser croire que plus personne ne veut être paysan ou paysanne. À quelques jours de l’ouverture du salon de l’agriculture, Terre de Liens bat en brèche l’idée selon laquelle il y aurait une crise des vocations.
Les candidat·es existent, mais un véritable plafond de terre les empêche d’accéder au foncier : l'accès aux terres est un tel parcours du combattant que seul·es 10 à 15 000 d'entre elles·eux s'installent chaque année. Or, il en faudrait 20 à 25 000 pour assurer la relève agricole. En effet, d'ici 2030, un quart des agriculteurs et agricultrices partira à la retraite.
Des paysan·nes sans ferme
La France ne manque pas de terres : 26 millions d’hectares de terres agricoles, soit la moitié du territoire métropolitain. Elle a de quoi nourrir bien plus que sa population. Pourtant notre souveraineté alimentaire est menacée : nous dédions 40% de nos terres à l’exportation, ce qui nous contraint à importer la production de neuf millions d’hectares.
Il est urgent de réorienter notre agriculture pour qu’elle ne soit plus tournée vers l’export et la spéculation mais vers sa fonction première : être nourricière. De nombreux candidat·es portent ce projet mais ils et elles n’arrivent pas à accéder aux terres agricoles : être informé·e qu’une ferme se libère est difficile, le prix de la terre est élevé et la régulation du marché est défaillante.
Des fermes intransmissibles
Un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations car le reste part à l’agrandissement. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société.
Louer plutôt qu’acheter grâce au portage foncier
Le portage foncier est un levier idéal pour l’installation : il permet à des structures d’acquérir des hectares pour les mettre à disposition de celles et ceux qui veulent les travailler sans s’endetter. Le rapport de Terre de Liens montre que certains acteurs du portage foncier recherchent une rentabilité qui aggrave la financiarisation du foncier agricole et qui est incompatible avec la transition agroécologique. Mais à rebours de ces modèles existe un portage des terres agricoles par et pour les citoyen·nes.
Un portage foncier d’intérêt général à portée de budget…
Ce portage foncier d’intérêt général contient des potentialités et externalités positives nombreuses : restructurer les fermes, créer des emplois, dynamiser les territoires, rendre le métier d’agriculteur plus attractif, assurer la fonction nourricière des terres agricoles, et accélérer la transition avec le bail rural environnemental. Autant de raisons qui font du portage foncier un dispositif à accompagner pour prendre à bras le corps la transformation de notre agriculture et le renouvellement des générations. Terre de Liens estime qu'avec 1,4 milliard d'euros par an, le portage foncier permettrait d'installer 7000 personnes de plus, et ainsi d'atteindre 75 % des besoins d'installations chaque année.
… mais sous-investi par le gouvernement
Si le président Macron a créé un "fonds Entrepreneurs du vivant" doté de 400 millions d’euros pour renouveler les générations agricoles, seuls 15 % seraient consacrés au portage foncier. Cette enveloppe de 80 millions d’euros sur 10 ans ne permettrait que 43 installations par an sur toute la France… là où le renouvellement des générations, et avec lui notre résilience alimentaire, nécessite l’installation de 10 000 agriculteur·trices supplémentaires par an. Les aides programmées à ce jour ne concernent donc que 0,5% des installations nécessaires.
Les moyens ne sont clairement pas au rendez-vous des ambitions du gouvernement qui a pourtant promis “d'investir dans une alimentation saine, durable et traçable, afin d’accélérer la révolution agricole et alimentaire sur laquelle la France est un pays leader” (France 2030, objectif 6).
Terre de Liens sera particulièrement attentif à ce que la prochaine grande loi agricole, promise en septembre 2022 par E. Macron, et dont l’arrivée devant le parlement devrait intervenir au printemps, apporte des réponses à la hauteur de l’urgence agricole, alimentaire et environnementale à laquelle la France fait face.
Pour consulter le rapport, cliquez ici
Lire la synthèse du rapport ici
Retrouvez ci-dessous le replay de la conférence de présentation du rapport organisée lors du Salon de l'Agriculture 2024 :

Terre de Liens dénonce dans un nouveau rapport le trop difficile accès aux terres agricoles. Alors que la France entend se doter en 2024 d’une loi en faveur du renouvellement des générations agricoles - duquel dépend notre souveraineté alimentaire, les nouveaux chiffres de Terre de Liens montrent qu’il sera impossible d’endiguer la disparition des fermes et des agriculteur·trices si le gouvernement ne réhausse pas drastiquement son investissement.
Telles que programmées, les aides de l'Etat couvrent 0,5% des besoins en installation.
Bientôt une France sans paysan·nes ?
La colère et le désespoir exprimés avec force lors des mobilisations de janvier pourraient laisser croire que plus personne ne veut être paysan ou paysanne. À quelques jours de l’ouverture du salon de l’agriculture, Terre de Liens bat en brèche l’idée selon laquelle il y aurait une crise des vocations.
Les candidat·es existent, mais un véritable plafond de terre les empêche d’accéder au foncier : l'accès aux terres est un tel parcours du combattant que seul·es 10 à 15 000 d'entre elles·eux s'installent chaque année. Or, il en faudrait 20 à 25 000 pour assurer la relève agricole. En effet, d'ici 2030, un quart des agriculteurs et agricultrices partira à la retraite.
Des paysan·nes sans ferme
La France ne manque pas de terres : 26 millions d’hectares de terres agricoles, soit la moitié du territoire métropolitain. Elle a de quoi nourrir bien plus que sa population. Pourtant notre souveraineté alimentaire est menacée : nous dédions 40% de nos terres à l’exportation, ce qui nous contraint à importer la production de neuf millions d’hectares.
Il est urgent de réorienter notre agriculture pour qu’elle ne soit plus tournée vers l’export et la spéculation mais vers sa fonction première : être nourricière. De nombreux candidat·es portent ce projet mais ils et elles n’arrivent pas à accéder aux terres agricoles : être informé·e qu’une ferme se libère est difficile, le prix de la terre est élevé et la régulation du marché est défaillante.
Des fermes intransmissibles
Un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations car le reste part à l’agrandissement. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société.
Louer plutôt qu’acheter grâce au portage foncier
Le portage foncier est un levier idéal pour l’installation : il permet à des structures d’acquérir des hectares pour les mettre à disposition de celles et ceux qui veulent les travailler sans s’endetter. Le rapport de Terre de Liens montre que certains acteurs du portage foncier recherchent une rentabilité qui aggrave la financiarisation du foncier agricole et qui est incompatible avec la transition agroécologique. Mais à rebours de ces modèles existe un portage des terres agricoles par et pour les citoyen·nes.
Un portage foncier d’intérêt général à portée de budget…
Ce portage foncier d’intérêt général contient des potentialités et externalités positives nombreuses : restructurer les fermes, créer des emplois, dynamiser les territoires, rendre le métier d’agriculteur plus attractif, assurer la fonction nourricière des terres agricoles, et accélérer la transition avec le bail rural environnemental. Autant de raisons qui font du portage foncier un dispositif à accompagner pour prendre à bras le corps la transformation de notre agriculture et le renouvellement des générations. Terre de Liens estime qu'avec 1,4 milliard d'euros par an, le portage foncier permettrait d'installer 7000 personnes de plus, et ainsi d'atteindre 75 % des besoins d'installations chaque année.
… mais sous-investi par le gouvernement
Si le président Macron a créé un "fonds Entrepreneurs du vivant" doté de 400 millions d’euros pour renouveler les générations agricoles, seuls 15 % seraient consacrés au portage foncier. Cette enveloppe de 80 millions d’euros sur 10 ans ne permettrait que 43 installations par an sur toute la France… là où le renouvellement des générations, et avec lui notre résilience alimentaire, nécessite l’installation de 10 000 agriculteur·trices supplémentaires par an. Les aides programmées à ce jour ne concernent donc que 0,5% des installations nécessaires.
Les moyens ne sont clairement pas au rendez-vous des ambitions du gouvernement qui a pourtant promis “d'investir dans une alimentation saine, durable et traçable, afin d’accélérer la révolution agricole et alimentaire sur laquelle la France est un pays leader” (France 2030, objectif 6).
Terre de Liens sera particulièrement attentif à ce que la prochaine grande loi agricole, promise en septembre 2022 par E. Macron, et dont l’arrivée devant le parlement devrait intervenir au printemps, apporte des réponses à la hauteur de l’urgence agricole, alimentaire et environnementale à laquelle la France fait face.
Pour consulter le rapport, cliquez ici
Lire la synthèse du rapport ici
Retrouvez ci-dessous le replay de la conférence de présentation du rapport organisée lors du Salon de l'Agriculture 2024 :